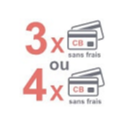1. Introduction / Contexte
Depuis le 1er janvier 2022, la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) est entrée en vigueur pour les constructions neuves. Elle remplace la RT2012 (réglementation thermique), mais ce changement n’est pas simplement “plus strict en isolation” : la RE2020 marque une rupture dans la manière de concevoir les bâtiments.
L’enjeu est double : réduire la consommation énergétique des bâtiments, mais surtout limiter leur empreinte carbone, en intégrant les émissions liées aux matériaux, à la construction, et à leur cycle de vie complet.
Pourquoi passer à la RE2020 ?
- Objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050, dans le cadre des engagements climatiques français.
- Le secteur de la construction est très émetteur (matériaux, énergie, chantier), il représente une part significative des émissions nationales.
- Il faut anticiper le réchauffement climatique : la RE2020 intègre désormais le confort d’été comme critère réglementaire.
La RE2020 n’est pas une norme optionnelle : c’est un cadre légal avec des exigences de performance. Elle s’inscrit dans une évolution réglementaire progressive : les seuils seront durcis dans le temps.

2. Les grands objectifs de la RE2020
La RE2020 repose sur trois piliers principaux :
- Sobriété énergétique et décarbonation
- Réduction de l’impact carbone global (matériaux + chantier + énergie)
- Garantir le confort d’été
-
2.1 Sobriété énergétique et décarbonation
La RE2020 impose des seuils pour la consommation d’énergie primaire du bâtiment (CEP) et d’énergie non renouvelable (CEPnr), ainsi que l’impact carbone lié à la consommation d’énergie (IC énergie). L’idée est de limiter l’usage d’énergies fossiles et de favoriser les sources décarbonées (pompes à chaleur, énergies renouvelables, réseaux de chaleur bas carbone)
Avec la RE2020, on n’impose plus seulement une isolation efficace, mais on incite le choix de systèmes de chauffage/froid “verts” et de la production locale d’énergie.
-
2.2 Réduction de l’impact carbone (Analyse de cycle de vie)
C’est l’élément le plus innovant : la RE2020 introduit le concept d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour le bâtiment, afin de mesurer l’impact carbone des matériaux, de la construction, de la maintenance, et de la fin de vie.
L’indicateur IC construction (impact carbone des matériaux + chantier) est désormais soumis à seuil. Les bâtiments devront être conçus avec des matériaux bas carbone, optimiser le réemploi, utiliser des fiches FDES fiables, etc.
-
2.3 Confort d’été
Un des grands apports de la RE2020 est la prise en compte du confort en période de forte chaleur, via l’indicateur DH (degrés-heures) qui ne doit pas dépasser un seuil réglementaire. Cela oblige les concepteurs à anticiper les vagues de chaleur, la ventilation naturelle, l’orientation, l’inertie thermique, etc.
3. Champ d’application et calendrier

-
3.1 Bâtiments concernés
La RE2020 s’applique principalement aux constructions neuves. Le périmètre est assez proche de celui de la RT2012, mais s’étend progressivement.
Les usages concernés :
-
- Maisons individuelles
- Logements collectifs
- Bureaux, bâtiments d’enseignement (primaire, secondaire)
- À terme : hôtels, commerces, gymnases, établissements de santé, etc.
-
3.2 Phases d’application dans le temps
-
- 1er janvier 2022 : application pour les maisons individuelles et logements collectifs.
- 1er juillet 2022 : extension aux bâtiments d’enseignement et bureaux
- En 2025, 2028, 2031 : renforcement progressif des seuils, notamment sur l’empreinte carbone.
- Le décret RETEX RE2020 (30 décembre 2024) modifie des exigences à la lumière des premiers retours d’expérience.
- Le guide “Éco‑construire pour le confort de tous” a été mis à jour dans ce contexte.
-
3.3 Cas particuliers : extensions, HLL, constructions temporaires
-
- Les extensions de maisons individuelles sont soumises à la RE2020 si le permis de construire ou la déclaration préalable est exigé, même pour de petites surfaces.
- Habitations légères de loisirs (HLL) : des modalités spécifiques (arrêtés) existent selon la surface.
- Constructions temporaires ou usages spécifiques peuvent bénéficier de dispenses ou modalités alternatives.
4. Indicateurs et seuils de performance
La RE2020 impose un ensemble d’indicateurs (énergie, carbone, confort) avec des seuils à ne pas dépasser. Ces indicateurs sont à résultats, pas seulement des prescriptions.
-
4.1 Indicateurs liés à l’énergie
-
- CEP (consommation d’énergie primaire) : total des consommations normalisées converties en énergie primaire.
- CEPnr (consommation d’énergie primaire non renouvelable) : portion non renouvelable de la consommation.
- IC énergie : impact carbone des consommations d’énergie du bâtiment pendant sa phase d’exploitation.
Ces indicateurs sont calculés selon la méthode Th‑C (Thermique Carbone) et tiennent compte des différents postes (chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, auxiliaires).
Les seuils sont modulés selon la localisation (zone climatique), la surface, les contraintes, etc.
-
4.2 Indicateurs liés à la matière / au carbone
Les matériaux biosourcés peuvent avoir un impact “négatif” s’ils stockent du carbone tant qu’ils ne sont pas émis. Le réemploi est valorisé (impact compté à zéro dans certains cas) selon les modalités réglementaires.
-
4.3 Indicateur de confort d’été (DH)
-
4.4 Indicateur bioclimatique (BBIO)
-
- BBIO (besoin bioclimatique) : indicateur qui mesure la qualité de la conception bioclimatique (orientation, apports solaires, isolation, ombrage).
- Il valorise une conception “passive” dès la phase esquisse. Un bâtiment très “BBBIO performant” aura des besoins réduits en chauffage, refroidissement, etc.
- Le seuil BBIO_max est modulé selon les contraintes (géographie, bruit, surface) via des coefficients de modulation (Mb, etc.).
-
4.5 Modulation des seuils selon critères
Les seuils “max” pour ces indicateurs (BBIO_max, CEPnr_max, ICe_max, etc.) ne sont pas fixes mais modulés :
-
- Géographie (zone climatique, altitude)
- Bruit (contraintes sonores)
- Surface / taille du lot
- Contraintes d’ensoleillement, d’ombre
- Type de bâtiment (usage, catégorie)
Cette modulation permet d’adapter les exigences au contexte local et de tenir compte des contraintes réelles du terrain et de l’architecture.
Ainsi, deux bâtiments identiques mais situés en zones différentes peuvent avoir des seuils légèrement distincts.
5. Méthodologie et calculs : l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) dans la RE2020
L’élément central d’originalité de la RE2020 est l’intégration de l’ACV dans l’évaluation environnementale du bâtiment.
-
5.1 Qu’est-ce que l’ACV et pourquoi c’est essentiel ?
L’Analyse de Cycle de Vie permet d’estimer l’impact environnemental (émissions de GES, etc.) d’un objet ou d’un bâtiment à toutes ses phases : extraction, fabrication, transport, mise en œuvre, usage, maintenance, fin de vie. Dans la RE2020, l’ACV est appliquée au bâtiment selon une durée de référence de 50 ans.
L’intérêt : aller au-delà de l’énergie et prendre en compte l’impact des matériaux, de la démolition, etc. Cet apport corrige les biais d’anciennes réglementations qui pouvaient privilégier des systèmes énergétiques efficaces mais très émissifs en fabrication.
-
5.2 Sources de données : FDES, base INIES
Pour réaliser l’ACV conforme RE2020, on utilise des données environnementales certifiées FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) et/ou PEP (Profil Environnemental Produit). Ces données sont centralisées dans la base INIES, la base officielle en France.
Il est impératif d’utiliser les données “dynamisées” (pondération temporelle) dans le contexte RE2020, ce qui diffère de l’ACV « statique » standard de certaines fiches INIES.
-
5.3 Prise en compte du réemploi, matériaux biosourcés, pondération temporelle
-
- Matériaux biosourcés : comme le bois, la paille, la fibre de bois, etc. Ils peuvent séquestrer du carbone tant qu’ils ne sont pas relâchés dans l’atmosphère. Dans l’ACV RE2020, on leur applique une pondération temporelle (méthode “dynamique”) pour valoriser leur stockage sur la durée.
- Réemploi / réutilisation : les composants issus du réemploi ou de la réutilisation peuvent être comptés comme ayant un impact nul (dans certaines conditions), ce qui les rend très attractifs pour améliorer le score carbone.
- Pondération temporelle : les émissions plus lointaines sont « valorisées » différemment pour tenir compte de l’urgence climatique, ce qui modifie le calcul par rapport à une ACV linéaire classique.
-
5.4 Lots de construction et périmètre ACV
L’analyse porte sur l’ensemble des lots (gros œuvre, second œuvre, isolants, menuiseries, équipements CVC, etc.). On distingue les composants (matériaux) et le chantier (mise en œuvre, déchets, transport) dans le calcul.
Il est important de bien définir le périmètre de l’analyse (inclusions, exclusions, hypothèses de renouvellement) pour éviter des biais ou des comparaisons injustes entre projets.
6. Contraintes, défis et bonnes pratiques pour se conformer
Pour répondre aux exigences de la RE2020, les projets doivent anticiper plusieurs verrous techniques et prendre des décisions dès la conception.
-
6.1 Choix de matériaux à faible empreinte carbone
-
- Prioriser les matériaux biosourcés (bois, chanvre, paille, isolants écologiques)
- Vérifier que les FDES soient disponibles et valides
- Minimiser les quantités, optimiser les sections, mutualiser les structures
- Favoriser le réemploi ou la réutilisation de composants existants
-
6.2 Optimisation de l’isolation & conception bioclimatique
-
- Bonne isolation (murs, toits, ponts thermiques)
- Orientation favorable pour capter l’énergie solaire en hiver
- Protection solaire (brise-soleil, volets, auvents) pour limiter les surchauffes
- Ventilation naturelle, inertie du bâtiment
Ces choix aident à réduire le besoin en chauffage/refroidissement, et donc à allouer un “budget carbone” pour d’autres postes.
-
6.3 Systèmes énergétiques adaptés
- Transition vers des systèmes non fossiles : pompe à chaleur, énergie solaire photovoltaïque, géothermie, réseaux de chaleur bas carbone
- Pour les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur qualifié, la RE2020 peut prendre en compte les performances du réseau en terme d’émissions.
-
6.4 Raccordement réseaux de chaleur / énergies renouvelables
- Si un réseau est “classé”, le bâtiment bénéficie de seuils moins pénalisants sur l’indicateur IC énergie (réseau “vert”).
- La RE2020 encourage fortement le recours à des énergies renouvelables locales.
-
6.5 Outils, simulation, attestations & contrôle
- Utilisation de logiciels validés pour les calculs (thermiques et ACV) : Pleiades, Archiwizard, etc.
- Récapitulatif Standardisé des Études Energétiques et Environnementales (RSEE) au format XML obligatoire à la réception.
- Contrôles de perméabilité à l’air + contrôle des installations de ventilation (nouveauté par rapport à la RT2012)
- Sanctions en cas de non-conformité : blocage du permis, pénalités financières.
7. Évolutions prévues & renforcement de la réglementation
-
7.1 Révisions 2025, 2028, 2031
La RE2020 prévoit un durcissement progressif des seuils carbone (et parfois énergétique). Le secteur doit anticiper une trajectoire descendante.
Par exemple, les seuils d’émissions carbone pour les bâtiments seront réduits tous les 3 ans pour inciter aux innovations.
-
7.2 Décret RETEX RE2020 et arrêtés modificatifs
Le décret RETEX RE2020 (31 décembre 2024) ajuste des exigences en s’appuyant sur les retours d’expérience des premières années.
Un des ajustements : certaines catégories de bâtiments (petites surfaces, HLL) bénéficient de dispositions adaptées.
-
7.3 Vers une RE2030 / RE2031
Certains considèrent que la RE2020 est une étape vers des normes encore plus exigeantes (on parle parfois de “RE2030 / RE2031”) dans lesquelles le carbone sera encore plus contraignant.
Cette trajectoire oblige les acteurs à anticiper les innovations (matériaux, techniques, process) dès maintenant.
8. Impacts pratiques, retour sur investissement et risques
-
8.1 Surcoût de construction et coût global
Oui, se conformer à la RE2020 engendre des surcoûts (matériaux performants, études ACV, contrôles, innovation). Mais ces surcoûts doivent être analysés en coût global (énergie, entretien, valeur du bâtiment).
-
8.2 Gains à long terme
- Réduction des coûts énergétiques
- Valorisation immobilière par label / performance environnementale
- Avantage concurrentiel / image « écologique »
- Moindre vulnérabilité aux futures normes
-
8.3 Études de cas / retours d’expérience
On constate dans les premières réalisations que les projets ayant anticipé la RE2020 (choix biosourcés, conception bioclimatique, optimisation ACV) obtiennent des résultats plus sereins et à moindre coût marginal.
-
8.4 Risques en cas de non-conformité
- Refus de permis de construire
- Sanctions financières
- Retard de livraison
- Image / confiance des clients / obligations contractuelles
9. Conclusion & recommandations
La RE2020 impose une transformation profonde de la conception du bâtiment. Elle pousse vers une approche plus “globale”, plus responsable. Pour réussir, voici quelques conseils :
- Intégrer l’ACV et la dimension carbone dès la phase esquisse
- Choisir des matériaux bas carbone ou réemployés
- Optimiser l’isolation, la conception bioclimatique, le confort d’été
- Prévoir des systèmes énergétiques décarbonés (pompe à chaleur, photovoltaïque, réseaux de chaleur)
- Utiliser des outils logiciels certifiés, anticiper les contrôles et attestations
- Suivre de près les évolutions réglementaires (2025, 2028, 2031)